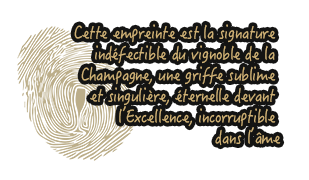Connaissez-vous bien toutes les tailles des bouteilles de champagne ?
A l'apéritif ou au cours d'un repas est somme toute banal. Autour d'une ou deux bouteilles de champagnes, les convives font preuve de commensalité et partagent un bon moment en savourant les meilleurs vins pétillants de la région. Mais plus on est nombreux, plus le nombre de bouteilles augmente. A l'inverse, un repas à deux ou trois ne nécessite pas toujours (modération oblige !) la présence d'une bouteille traditionnelle. Alors, comment s'y retrouver ? Voici une petite liste des différents contenants utilisés pour le vin de champagne.
Les petites bouteilles de champagne
Le huitième (9,4 cl, soit 3/4 d'une coupe de champagne) :
Cette bouteille est quasiment introuvable aujourd'hui, et ce sont surtout les collectionneurs qui se l'échangent. Pour les plus férus d'histoire du champagne, sachez que c'est cette petite (minuscule) bouteille qui fut expédiée, il y a de nombreuses années, aux militaires américains afin de leur faire déguster les grands vins français.
Le quart (18,75 ou 20 cl, soit une coupe et demi de champagne) :
La bouteille idéale pour les amateurs de champagne en solo. C'est la plus petite des bouteilles de champagne commercialisées (les compagnies aériennes et les boîtes de nuit les servent chaque jour par milliers à leurs clients). Le quart prend parfois la forme d'une œuvre d'art, car son format sympa et chaleureux, très apprécié des maisons de champagne, pousse à la réalisation d'habillages très personnalisés et originaux. D'où l'intérêt de nombreux collectionneurs, là encore, qui scrutent et recherchent les perles rares au look peu commun.
La demie (37,5 cl, soit 3 coupes de champagne) :
C'est la bouteille de champagne idéale pour les tête-à-tête en amoureux et les moments d'intimité complice. On la trouve facilement dans le commerce, chez les détaillants en vin, mais également dans les restaurants, où elle fait souvent partie de la carte.
Le médium (60 cl, soit 5 coupes de champagne) :
Un format aujourd'hui quasiment inusité. Si vous trouvez une bouteille de champagne de cette contenance, merci de me faire signe !
Les bouteilles de champagne traditionnelles
La Champenoise (75 cl, soit 6 coupes de champagne - 30 cm de hauteur environ) :
Tout le monde la connaît, c'est la bouteille de référence, celle que vous retrouvez dans tous les commerces et chez les vignerons de Champagne. Si cette bouteille "champenoise" est apparue vers la fin du XVIIIe siècle, son col était alors plus fin et son bouchon plus petit qu'aujourd'hui.
Le Magnum(1,5 litre, soit 12 coupes de champagne - 37/38 cm de hauteur :
Autre grand classique des bouteilles de Champagne, le Magnum correspond à 2 bouteilles champenoises (d'où le nom, tiré du latin "magnums", qui traduit l'idée de grandeur). Bouteille correspondant à 2 bouteilles ordinaires, soit 1,5 litre
Tiré de l'adjectif latin "magnums" qui signifie grand. L'origine de l'utilisation du mot pour une "grosse bouteille"
remonte à 1788 en Angleterre. En latin Magnum est synonyme de grandeur et magnificence.
Parfait à servir quand vous êtes plus de 4 convives à table, le Magnum permet une meilleure conservation du champagne, qui y vieillit plus lentement. Régulièrement servi lors des grands moments de fêtes, le Magnum est indispensable dans toute bonne cave qui se respecte.
LE JEROBOAM environ 47 cm de hauteur :
Belle bouteille équivalent à 4 bouteilles ordinaires soit 3 litres.
Jéroboam était le fondateur du royaume d’Israël et le 1er roi d’Israël (933 à 910 av. J.-C.). Il se fit élire par les
10 tribus du Nord qui s’étaient soulevées contre Rehoboam, fils de Salomon. Ce schisme politique se doubla d’un
schisme religieux en créant deux nouveaux lieux de culte Dan et Béthel, qui firent concurrence à Jérusalem.
Connu dans le Bordelais sous le nom de double-magnum, le Jéroboam équivaut à 4 bouteilles champenoises. S'il est le plus demandé des grands flacons champenois, c'est aussi le premier contenant à bénéficier d'un nom tiré de la Bible : Jéroboam étant le fondateur et le 1er roi d'Israël, au Ier millénaire avant JC.
LES GRANDS FLACONS DE CHAMPAGNE… plus rares, mais festives
LE REHOBOAM
Contenance 6 bouteilles - 4,50 L
Roi de Juda (v. 930-v. 915) et fils de Salomon, il provoqua, par son gouvernement tyrannique, le schisme
des dix tribus du Nord, qui formèrent le royaume d'Israël. Lui-même conserva sous sa domination les deux
tribus de Juda et de Benjamin.
Le Réhoboam (4,5 litres, soit 36 coupes de champagne - 56/58 cm de hauteur) :
Correspondant à 6 bouteilles traditionnelles, le Réhoboam n'est plus commercialisée depuis plus de 30 ans. Son nom serait tiré lui aussi de la Bible : Roboam, roi de Juda, était le fils du roi Salomon. D'autres sources affirment que ce nom est issu d'un terme propre au savoir-faire monastique champenois.
LE MATHUSALEM ou IMPERIALE
Très belle bouteille équivalant à 8 bouteilles ordinaires, soit 6 litres .Patriarche biblique de l’Ancien Testament qui
passe pour avoir vécu 969 ans ou 720 ans.
LE SALMANAZAR 9 litres, soit 72 coupes de champagne - 68 cm de hauteur :
Très belle bouteille équivalant à 12 bouteilles ordinaires, soit 9 litres.
Cinq rois d'Assyrie portèrent ce nom. Le plus célèbre fut Salmanazar III (858 à 823 avant JC) C’était le fils
d’Assour Nassirpal.
Avec son équivalence à 12 bouteilles de champagne, le Salmanazar doit son nom au Roi d'Assyrie. Si son histoire n'est pas très connue, les historiens savent que ses conquêtes furent nombreuses.
LE BALTHAZAR
Le Balthazar 12 litres, soit 96 coupes de champagne - environ 70 cm de hauteur :
Une bouteille qui porte le nom d'un des 3 rois mages venus d'Orient (d'Afrique noire dans la tradition) pour adorer l'enfant Jésus à sa naissance. Il vous faudra 16 bouteilles champenoises traditionnelles pour faire un Balthazar.
Deux célèbres Balthazar peuvent avoir été à l'origine du nom de cette bouteille imposante. L’un deux était le fils
de Nabonide et le régent de Babylone, tué par Cyrus vers 539 avant J.-C. Balthazar est aussi le nom de l’un des
trois Rois mages qui suivirent l’étoile miraculeuse jusqu’à la crèche de Bethléem où ils adorèrent l’enfant Jésus.
LE NABUCHODONOSOR
Nabuchodonosor (605-561 av. J.-C.), fils de Nabopolassar, fut l’un des plus célèbres rois de Babylone. C’est lui
qui déplaça les juifs de Jérusalem à Babylone après la chute de la ville sainte. Grand constructeur, Nabuchodonosor
s’est attaché à embellir Babylone, la dotant de jardins suspendus célèbres à travers tout le monde antique et d’enceintes de toute beauté (dont faisait partie la porte d’Ishtar conservée aujourd’hui à Berlin).
LE MELCHIOR
Bouteille géante équivalent à 24 bouteilles ordinaires, soit 18 litres
LE MELCHISEDECH
( Ancien roi de Salem )
Bouteille de 30 litres soit l'équivalent de 40 bouteilles
Flacon hauteur : 1 mètre10 et 52 kilos pleine
Le Nabuchodonosor (15 litres, soit 120 coupes de champagne - environ 76 cm de hauteur) :
La bouteille des merveilles, puisque le nabuchodonosor est le plus grand des flacons "traditionnels" dans le monde du champagne. Correspondant à 20 bouteilles champenoises, il doit son nom au roi de Babylone, en Mésopotamie, qui fit créer notamment les magnifiques jardins suspendus babyloniens, l'un des 7 merveilles du monde antique.
Les bouteilles de champagne extravagantes de la Maison Drappier
Le Salomon (18 litres, soit 144 coupes de champagne - environ 78 cm de haut) :
Connu sous le nom de Melchior dans le Bordelais, le Salomon correspond à 24 bouteilles champenoises. La Maison Drappier, qui l'a créé, lui a donné le nom du roi d'Israël, célèbre pour sa sagesse relatée dans l'Ancien Testament, et qui fit régner le calme et la prospérité dans son royaume.
Le Souverain (26,25 litres, soit 210 coupes de champagne - environ 102 cm de haut) :
Si cette bouteille de champagne à la taille spectaculaire ne porte pas un nom biblique, contrairement à ses sœurs, c'est que la première bouteille de ce genre fut conçue en 1988 pour l'inauguration du plus grand paquebot du monde, le "Sovereign of the sea". Consommée uniquement lors d'événements exceptionnels, cette bouteille équivaut à 35 bouteilles champenoises, et n'est pas l'apanage de la Maison Drappier.
Le Melchizédec (30 litres, soit 240 coupes de champagne - environ 110 cm de hauteur) :
Ce sont les chiffres qui résument le mieux l'extravagance de cette bouteille : 54 kilogrammes, 40 bouteilles champenoises en équivalence, 750 euros de prix de revient vide et 10 exemplaires seulement commercialisés chaque année… La bouteille inventée par Michel Drappier emprunte son nom au personnage biblique, roi de Salem en Canaan, au temps d'Abraham.
Vous savez désormais tout au sujet des bouteilles de Champagne. Si le nom biblique de ces flacons ne s'explique pas, un moyen mnémotechnique simple permet de se souvenir des principales tailles dans leur ordre de contenance. Retenez la phrase : "Car De Bon Matin Je Remarquais Mal Sa Banalité Naturelle" (Quart / Demi / Bouteille / Magnum / Jéroboam /
L'évolution de la bouteille de Champagne
À l’été 2010, le repêchage de 168 bouteilles de champagne enfouies dans une épave gisant au large des îles Åland, en mer Baltique, a eu un retentissement mondial. Présentées d’abord comme contemporaines des années 1780, puis datées avec précision du tournant des années 1830-1840, ces bouteilles furent produites, probablement à destination du marché russe, par les maisons Juglar – aujourd’hui disparue –, Veuve Clicquot-Werlé et Heidsieck & Co. Après ouverture et dégustation par des œnologues, 70 d’entre elles ont été déclarées en état d’être consommées, puis rebouchées à neuf dans la perspective d’une vente aux enchères. À la faveur de cet événement, on s’est émerveillé devant la qualité de ces vins, mais on a prêté beaucoup moins d’attention au contenant, sans doute parce que tout le monde, aujourd’hui, est habitué à voir les vins voyager en bouteilles de verre à travers l’Europe et le monde. Pourtant, cette réalité matérielle est le résultat d’une remarquable évolution historique, qui n’était pas encore arrivée à son terme à l’époque où ces champagnes furent commercialisés.
De fait, la bouteille est restée longtemps cantonnée à un rôle marginal dans le monde des échanges. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, à peu près partout en Europe, la quasi-totalité des boissons – bières, cidres, vins et spiritueux – comme des autres liquides comestibles – huiles et vinaigres de table – sont vendus en gros et transportés au loin dans des tonneaux de bois de toute forme et de toute contenance. Le négoce ignore donc la bouteille, ou l’utilise tout au plus pour l’envoi d’échantillons, qui permettent aux acheteurs de goûter les produits sans avoir à se déplacer. Pour le reste, l’usage de la bouteille se concentre en bout de chaîne : elle est le récipient de la vente au détail que le marchand ou l’aubergiste remplit au tonneau à la demande du client, et encore n’est-elle pas le plus répandu, car sa capacité paraît souvent mal garantie aux yeux du public et des autorités, elle est un objet de la vie domestique que les particuliers emploient à table ou à la cuisine, sans avoir toutefois la distinction de la carafe ou d’autres récipients ouvragés.
Ce n’est qu’au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’un changement de grande ampleur s’amorce, du moins dans le commerce des vins. En France en particulier, les progrès accomplis dans la vinification font que certains bourgognes, bordeaux ou champagnes rouges vieillissent de mieux en mieux, notamment lorsqu’ils sont conservés en bouteilles, fermées de préférence par un bouchon de liège, éventuellement recouvert d’un capuchon de cire. En outre, les champagnes blancs mousseux, qui connaissent un vif succès dès leur apparition, imposent peu ou prou un conditionnement en bouteille. Or, cette émergence des vins de qualité profite des progrès de la verrerie : alors que la plupart des bouteilles du XVIIe siècle étaient presque aussi fines que des verres à boire, au point de devoir être clissées, c’est-à-dire doublées d’une enveloppe d’osier pour les protéger du moindre choc, celles du XVIIIe siècle gagnent en épaisseur et en solidité. Cependant, cette amélioration est progressive et la production reste longtemps inégale, ce qui est surtout fâcheux pour les champagnes mousseux : les années où le vin est spécialement effervescent, jusqu’à un tiers des bouteilles, voire davantage, peuvent éclater de manière spontanée. Mais, outre que la casse recule au fil du siècle avec l’élévation de la qualité du verre, jamais elle ne dissuade les acheteurs.
Il est vrai que les vins de qualité conditionnés en bouteilles sont aussitôt adoptés par les élites européennes, qui en font un objet de distinction
sociale dès les premières décennies du XVIIIe siècle. On sait que la demande de la haute société britannique joue un rôle moteur dans l’exportation des grands crus de Bordeaux sous cette forme, même si, longtemps, l’embouteillage n’est pas l’affaire des châteaux de production, mais des négociants en vin. On peut aussi rappeler que deux des plus célèbres tableaux contemporains où l’on voit des bouteilles de vin à table, Le déjeuner de jambon de Lancret et Le déjeuner d’huîtres de Troy, représentent l’un et l’autre des agapes aristocratiques. Du reste, ces tableaux sont des commandes de Louis XV en personne, pour l’aménagement de ses petits appartements à Versailles en 1735. Par un hasard, qui, au fond, n’en est pas tout à fait un, cette année est précisément celle où la monarchie s’efforce de réglementer la bouteille : une déclaration fixe pour tout le royaume, et donc aussi pour l’exportation, la contenance à 1 pinte (0,93 litre) et le poids de verre à 25 onces (0,98 kilogramme). Quoique cette tentative d’uniformisation se heurte à des obstacles et laisse subsister une grande variété de formes dans les bouteilles, elle témoigne d’une volonté de garantir la capacité et la solidité de ce récipient, au bénéfice du consommateur et du commerce.
Pour autant, la suprématie de la bouteille est encore loin d’être assurée à la fin du XVIIIe siècle : son coût et son poids l’empêchent évidemment de conquérir le marché des liquides ordinaires, mais ils l’empêchent même de régner sans partage dans le domaine des boissons de qualité. Ainsi, dans le traité de commerce franco-russe de 1787, dans lequel sont notamment fixés les droits de douane appliqués aux champagnes et aux bourgognes entrant en Russie, une claire distinction est maintenue entre ceux qui arrivent en barriques et ceux qui arrivent en bouteilles, alors que la clientèle de ces vins est indéniablement aristocratique. Plus éloquent encore, le basculement du commerce des cognacs, des tonneaux vers les bouteilles, n’a pas lieu avant les premières décennies du XIXe siècle, alors que cette boisson a connu un prodigieux essor qualitatif et commercial au cours du XVIIIe siècle.
Quant à ces bouteilles de champagne sorties de la Baltique dont je vous parle en début de texte, bouteilles apparemment si familières, elles ne sont pas tout à fait les nôtres. Leur bouchon était encore de ceux qui se maintenaient avec des ficelles et non des muselets de métal, elles ne portaient pas d’étiquette d’origine, ce qui était la règle à cette époque : l’identification de leur maison de production a d’ailleurs exclusivement reposé sur les marques à feu imprimées sous les bouchons.
Il fallut encore des décennies pour que la bouteille devienne, techniquement et commercialement, le récipient usuel des comestibles liquides. C’est dire si, malgré sa grande ancienneté et son apparente banalité, la bouteille de verre est le produit d’une longue aventure européenne, dont l’élan décisif a été donné au XVIIIe siècle.